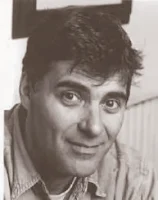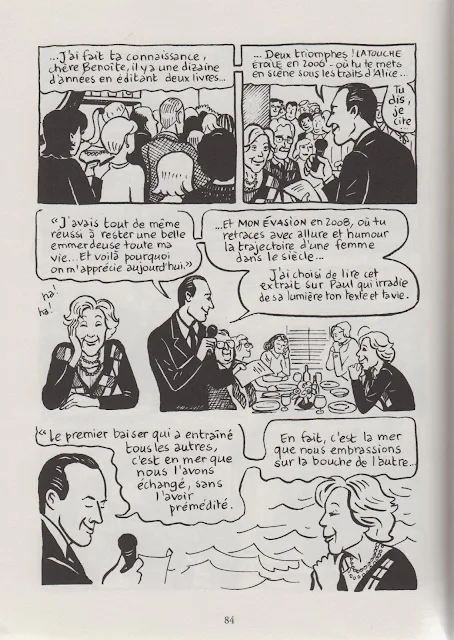"Lire, c'est magique"
Quelques mots qui disent tout de Mario Ramos.
Mario qui nous a quittés le 16 décembre 2012.
Mario qui était né à Bruxelles le 7 novembre 1958.
La tristesse et le chagrin demeurent. On n'en parlera pas aujourd'hui.
Car ses livres sont toujours là, disponibles en librairie, en bibliothèque, ou peut-être chez vous, sur un rayon ou dans une caisse. Ses albums, une trentaine, avec leur joie, leur drôlerie, leur bonne humeur, leurs messages, leur magie. "Avec un crayon et du papier, tout est possible. C'est magique!", répétait à l'envi le souriant Mario.
C'est la raison pour laquelle les éditions Pastel, branche belge de L'école des loisirs, son éditeur, et le CLJBxl (Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles) ont choisi sa date d'anniversaire, le 7 novembre, pour en faire la Journée Mario Ramos. Une journée pour, tout simplement, mettre en évidence les trois dizaines d'albums que Mario a créés, pour les tout-petits, pour les enfants en classes maternelles, pour ceux en classes primaires.
Il y a les histoires du loup bien entendu, celles du lion, de l'éléphant, des singes, tous ces animaux auxquels les humains ressemblent tellement, celles où il revisitait les contes ou les chansons... Autant de livres où il s'amusait et nous amusait tous, petits et grands.
 |
| Mario Ramos. (c) Tania Ramos. |
 Il y a encore
Il y a encore"Le petit Guili" (Pastel,
40 p.), album posthume, sorti au printemps parce que terminé au décès de Mario. Avec sa formidable couverture.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." La phrase de Mark Twain précède cette nouvelle histoire de roi lion, Léon cette fois. Un album qui scrute les limites d'un pouvoir autoritaire, mâtiné d'humour comme lorsque les gorilles du roi sont payés en cacahuètes, mais qui n'évite pas un sujet plus difficile: l'apparition de la cruauté. Le roi Léon change les lois selon son humeur, se révèle de plus en plus despotique. Il fait régner la peur et sème lui-même les premières graines de la révolte à son encontre.
 |
| Le roi Léon déclare la guerre à son voisin pour détourner l'attention. (c) Mario Ramos/Pastel. |
Cette révolte sera personnalisée par Guili, un jeune oiseau élevé par une mère généreuse et aimante (il est son "petit Guili chéri"). Un peu clown, un peu casse-cou, résistant et audacieux parce que persuadé d'avoir raison, et hors de portée de ses poursuivants car il est "un petit oiseau qui vole librement".
 |
| Le petit Guili et sa maman. (c) Mario Ramos/Pastel. |
Sacré petit Guili qui inaugure un jeu avec la couronne du roi Léon qu'il a chipée en la posant sur le crâne de toutes les autres espèces animales. Mais chaque fois, le petit oiseau juge "Ridicule" la proposition royale de l'animal couronné. Il prendra en finale une décision définitive par rapport à cette couronne nocive et choisira encore un autre chemin pour lui.
Dans cet album, Mario Ramos a légèrement modifié sa manière de dessiner. Si on reconnaît bien sa suite d'animaux, il joue ici aussi habilement avec des fonds de couleur et des ombres chinoises, avec ses aplats et des découpages, toujours retouchés au crayon. Un procédé sobre et expressif, très réussi.
 |
| Le gorille est le dernier à tester la couronne du roi Léon. (c) Mario Ramos/Pastel. |
Surtout, "Le petit Guili" rappelle qu'il ne faut jamais se laisser briser les ailes.
Et ça, c'est pile dans le thème de la Journée Mario Ramos.
Chaque 7 novembre, rappelez-vous de lui et de ses livres.