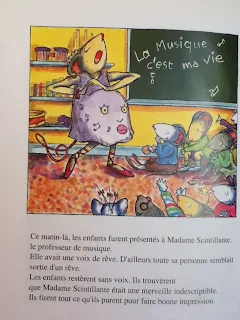en compagnie de
Douglas Kennedy.
Et qu'il lui explique comment et pourquoi
il a écrit
"Cet instant-là",
son dixième roman
qui se déroule à Berlin
et dont la traduction française vient de paraître chez Belfond.
"Cet instant-là", c'est un beau grand
roman d'amour tragique, entre manipulations et trahisons, une splendide
reconstitution historique de l'époque de la Guerre froide, révolue depuis moins de 25 ans, et un
suspense plein de rebondissements remarquablement orchestré. C'est évidemment une réflexion sur la recherche du bonheur et une interrogation sur ce qui motive des choix intimes impliquant des conséquences sur toute une vie. C'est surtout un livre passionnant, digne du qualificatif de "page turner" dans ce qu'il a de meilleur.
Tout commence quand Thomas Nesbitt, écrivain, reçoit chez lui, dans le Maine, deux lettres.
La première est une demande en divorce.
La seconde est un colis venant d'Allemagne, composé de cahiers et de lettres, adressé à lui via sa maison d'édition américaine, par un certain Johannes Dussman.
Voilà le personnage principal obligé de plonger dans son passé et de régler ses comptes.
Car il est allé à
Berlin en 1984, quand, jeune écrivain se destinant aux récits de voyages, après un premier livre sur l'Egypte, il envisageait d'écrire sur la ville coupée par le Mur.
Il avait fait plein de rencontres. Celle de Petra Dussmann, une traductrice que l'Allemagne de l'Est a expulsée à l'Ouest, qui deviendra son grand amour dès l'instant où il la voit. Celle d'Alistair Fitzsimmons-Ross, un peintre homosexuel à qui il louera une chambre. Celle du personnel de Radio Liberty, qui diffuse la bonne parole américaine. Celle de différents membres de services secrets...
A cette époque, Berlin est coupée en deux. L'écrivain de 25 ans le fait très bien percevoir quand il raconte ses excursions à l'Est grâce à son
"visa de Cendrillon": libre circulation durant une journée mais retour obligatoire avant minuit.
C'est un Berlin presque oublié qui jaillit des pages de Douglas Kennedy, d'autant plus crédible que l'écrivain américain s'y est établi un nouveau pied-à-terre il y a déjà trois ans. Il habite dans le quartier de
Mitte, dans l'ancien Berlin-Est, magnifiquement restauré aujourd'hui, là où tous les nouveaux arrivants s'installent.
Pour peu qu'on connaisse la ville, on circule dans Berlin pour de vrai en lisant "Cet instant-là".
Pour évoquer ce couple pris dans la tourmente de l'Histoire, nous avons pris le thé avec Douglas Kennedy, dans le très sélect
Hôtel Adlon.
Qu’est-ce qui est romancé et qu’est-ce qui est autobiographique peut-être dans ce nouveau livre ?
Il n’y a pas de Petra dans ma vie, il n’y a pas d’Alistair. En même temps, c’est un livre très personnel.
Mais il y a un Thomas Nesbitt ?
Ce n’est pas directement autobiographique sauf la scène du début, dans l'appartement, avec les parents. Quand enfant, il fuit et goûte la liberté pour la première fois. Il se réfugie dans la pharmacie avec son livre et son coca. Et puis il revient. Sa mère a commencé à écrire un livre dont il lit une page et elle le frappe. Cela vient de ma vie. En même temps, j’ai changé des choses. J’avais deux frères cadets. Nous étions tous ensemble dans le même appart à Manhattan. On n’avait pas beaucoup d’argent. C’était la classe moyenne.
Mais il y a des ressemblances entre vous et Thomas?
Je vis dans le Maine comme Thomas. Je suis divorcé comme Thomas. J’ai la cinquantaine comme Thomas. Mais j’ai deux enfants. En dehors de cela, j’ai utilisé le fait que Thomas est passionné de récits de voyage et que le premier sujet qu’il a traité est l’Egypte, comme moi ! En dehors de cela, j’ai tout inventé. Je déteste l’autofiction parce qu’il n’y a pas de distance. Mais j’ai décidé d’utiliser certains aspects personnels dans ce livre.
La fin est bouleversante.
Il y a une question primordiale dans ce livre : si on regarde sa vie intime, que voit-on ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses faibles, tristes, mais on voit une réflexion de sa propre vie. J’ai commencé à réfléchir à cela lors de mon divorce. J’ai commencé à écrire ce roman après trois-quatre mois de lutte avec mon ex-femme qui avait entamé le processus. A un moment, j’ai décidé: ok, c’est cuit. Tu veux un divorce ? Tu auras un divorce. C’est foutu. Le lendemain - j’étais à Montréal, j’ai passé une nuit blanche et j’ai commencé à écrire le livre. Le divorce a encore duré huit mois. L’écriture a duré deux ans.
Ce roman a-t-il été écrit comme à votre habitude ? Vingt pages par jour et les coupes ensuite ?
Ça dépend. Avec "Quitter le monde", c’était deux ans. Avec "La poursuite", c’était dix-huit mois. "La femme du Ve", c’était cinq mois mais c’était cauchemardesque.
Le roman est devenu mon équilibre, mon refuge, et aussi une discipline primordiale. Parce que c’est impossible de contrôler des événements en dehors de la vie, en dehors de moi. Mais on peut contrôler la fiction. Dans ce livre, il y a des thèmes omniprésents : comment et pourquoi on tombe amoureux, comment et pourquoi on évite le bonheur.
Et aussi qui est-on sous l’apparence qu’on donne ?
Oui mais c’est un thème omniprésent dans tous mes livres.
Et aussi pourquoi on trahit ? La trahison n’est pas toujours aussi simple qu’elle en a l’air. Il peut y avoir des choses en-dessous.
La plus grande trahison, c’est contre soi-même. C’est la tragédie centrale de ce livre. Et peut-être le fait qu’à cause de ses ombres, de sa société et d'un système paranoïaque, Petra est complètement amoureuse de Thomas. Mais elle n’a pas confiance en lui, et ça, c’est la tragédie. Pour Thomas, c’est à cause de son enfance et de beaucoup de choses. Le fait qu’il lutte avec lui-même tout le temps, le fait qu’il a découvert qu’elle l’a trompé. Mais il n’a pas posé la question : pourquoi ? explique-moi!
Chacun est le résultat de son éducation aussi, non ?
Tout à fait. On répète les faiblesses et les blessures de l’enfance pendant toute sa vie.
Comment est né le personnage de Petra ? Avec ses couches multiples ? Quand on la rencontre dans le roman, on ne se doute pas de ce qui va arriver.
Il y a des surprises énormes dans le roman. On n’a aucune idée des vérités que le mec de la CIA va révéler mais en même temps, on comprend qu'il y a une histoire derrière l’histoire.Pour Thomas, quand il lit le journal intime de Petra, c’est horrible. A la fin aussi, il y a plusieurs révélations aussi Quand j’ai commencé à construire le personnage de Petra, j’ai toujours eu l’idée de quelqu’un qui a un secret, ou qu’elle est gênée de montrer certaines choses à Thomas. Et puis on va découvrir ce qu'elle cache. Je suis très fier ce roman qui est comme des poupées russes. On en ouvre une, on en trouve une autre.Mais j’adore Petra. On a beaucoup d’empathie pour elle. En même temps, elle n’a pas confiance.
Ce qui est aussi glaçant dans votre roman, c’est la force des services secrets.
J’ai écrit un roman historique avec un couple au milieu des forces historiques. Comme Primo Levi l’a dit, on ne peut pas comprendre la mort de huit millions de Juifs, mais on peut comprendre Anne Frank
C’est pour cela que le livre se passe à Berlin ?
Oui. Quand j’ai vécu en Allemagne et que j’ai visité Berlin en 1983, pendant la Guerre froide, c’était passionnant parce que c’était une ville divisée. J’ai commencé par réfléchir à cette histoire, j’ai pensé aussi au fait que dans le récit, tout le monde est divisé.
Le choix de Berlin divisée est-il en rapport avec votre divorce ?
Tout à fait. Je pense que psychologiquement le roman est très complexe. On se dit: OK voici le trajet. Et puis non. On pense d’abord comme Thomas: "Oh mon Dieu, cet agent de la Stasi, quelle horreur!". Et puis on trouve une histoire en parallèle. Quand j'écris un roman, je pense tout le temps aux motivations psychologiques. Et aussi au fait que, derrière toutes les grandes décisions humaines, il y a cinq choses, dont trois sont subconscientes. On prend des décisions immenses dans la vie sans réflexion. J’ai fait ça. J’y ai réfléchi après mon divorce. Pourquoi avais-je choisi cette femme ? Pourquoi elle m’avait choisi ? On a su dès le début qu’il y avait des choses très problématiques. Mais c’est humain. La plupart des vies sont comme ça. C’est comme Kierkegaard a dit : "Il faut vivre au présent, il faut comprendre le passé".
Où étiez-vous en novembre 1989 quand le Mur est tombé ?
J’étais chez moi, à Londres. C’était trois ans avant la naissance de mon fils. Il est né en 1992 et j’ai vécu dans un très petit appart. On a déménagé de Dublin en 1988, on n’avait pas d’argent, j’avais terminé « Au pays de Dieu ». Je suis revenu à Berlin six mois après la chute du Mur. Mais je me souviens très bien du mois de novembre. J’ai vu des reportages à la télé et j’ai commencé à pleurer. J’étais bouleversé! C’était extraordinaire. Je me souviens que six mois avant, lors d’un dîner à Londres, l’idée d’une Allemagne unifiée paraissait impossible. J’avais tort.
Ce livre s’est-il construit comme les autres, à l’écriture ?
Je commence toujours avec le premier mot et je termine avec le dernier. Je n’écris pas de sections. Cela me serait impossible. Je découvre au fur et à mesure. J’ai le début, j’ai le problème central quand je commence un roman et j’ai deux-trois idées de fin. J’ai une scène en tête au début du roman. C'était celle où Thomas est à Berlin avec Johannes. Il voit le bureau de Petra. Il y voit tous ses livres, traduits, et il pleure. J’avais cette idée au début du roman. Mais le reste, je l’ai inventé pendant l’écriture. C’est ma méthode.
Est-ce que comme il est écrit dans le livre, la malédiction de l’écrivain est d’être seul ?
C’est toujours la vérité et en même temps c’est l’inverse. C’est la malédiction et aussi le plaisir. J’ai fait une conférence il y a deux ans à l’université d’Avignon. Quelqu’un m’a demandé : "comment devenir Douglas Kennedy ?" J’ai ri et j’ai répondu : aimez-vous la solitude parce que la solitude est mon voisin ? voulez-vous lutter avec beaucoup de déceptions ? et avez-vous vingt ans ? Parce que, honnêtement, l’écriture est un art et un métier. Il faut écrire, tout simplement,, et continuer à s'améliorer. J’espère que si on regarde maintenant mon travail, treize livres, ce n'est pas le même roman tout le temps. Il y a des thèmes semblables. C’est normal. Mais j’ai changé de style à chaque roman.J’ai beaucoup changé dans ma vie. Du moins, je l’espère. Sinon on a une vie statique. Sinon, on n’apprend rien. La fin du livre est triste, assez mélancolique. Mais elle a aussi un aspect dynamique. Comme si je disais: il faut continuer. A la fin, la fille de Thomas Nesbitt reproduit les mêmes erreurs qu’il a faites.Mais on ne peut pas vivre à la place de ses enfants. Maintenant il sait que c’est ça la vie et la condition humaine. Je répète souvent qu'il faut vivre avec des espérances. Autrement quel est le but ?
Comment vous viennent les noms des personnages ?
Quand j’ai étudié à l’université de Dublin, il y avait beaucoup d’aristos comme Alistair.Comme je veux écrire contre les clichés, j'ai fait d'Alistair un accro à l’héroïne et un homosexuel. Il est un peu louche et en même temps, il est très discipliné, très talentueux. J’adore Alistair. Tout le monde l'adore. Aussi parce qu'il comprend ce qui se passe, il voit la vérité de la situation. Il a dit à Thomas: "tu as gâché sa vie, tu as ruiné sa vie". C'est la vérité.
Et Thomas Nesbitt, cela sonne bien.
Mon père s’appelle Thomas.
Où est le bonheur?
Une des choses les plus importantes de ce roman, c’est l’idée que la vie intime est une grande réflexion de tout chez soi. Si on cherche tout le temps le bonheur, on cherche tout le temps l’idée qu’il y a quelqu’un désigné pour vous. La vérité c’est à 99% du temps autre chose. Mais on lutte tout le temps avec cela. C’est le rêve humain.J’ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses pendant et après mon divorce, à propos de ce mariage, des enfants. Je n’ai pas fait face à des choses évidentes au début. Et voilà.Parce qu’on ne nous apprend pas à dire non. Et aussi parce que c’est rare un mariage de trente ou quarante ans. Mais je suis sûr que sous le vernis, il y a beaucoup de luttes, beaucoup de problèmes.C’est la condition humaine. C’est le rêve impossible.Peut-être parce qu’on veut avoir beaucoup ou tout.En même temps, il faut continuer à rêver. Et ça, c’est la chose la plus importante.
 Florence Parry Heide avait 92 ans.
Florence Parry Heide avait 92 ans. Le rapetissement de Treehorn
Le rapetissement de Treehorn Le rapetissement de Treehorn
Le rapetissement de Treehorn