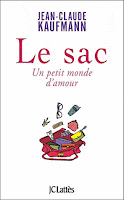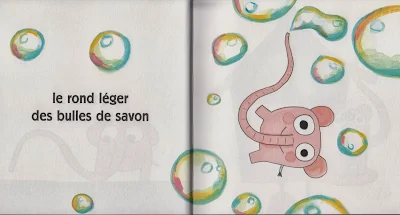L'automne dernier, Toni Morrison participait à l'épatant Festival America (Vincennes, 20-23 septembre 2012). Il y a un an, et c'est comme si c'était hier. Entendre parler cette toute grande dame de la littérature américaine, née en 1931 et récompensée en 1993 par le Nobel de littérature, est un bonheur absolu, une nourriture parfaite pour l'âme et l'esprit. La lire, c'est pareil.
L'automne dernier, Toni Morrison participait à l'épatant Festival America (Vincennes, 20-23 septembre 2012). Il y a un an, et c'est comme si c'était hier. Entendre parler cette toute grande dame de la littérature américaine, née en 1931 et récompensée en 1993 par le Nobel de littérature, est un bonheur absolu, une nourriture parfaite pour l'âme et l'esprit. La lire, c'est pareil.Son dernier roman en date, "Home" (traduit par Christine Laferrière, Christian Bourgois, 2012), est un bijou de finesse. Il vient de paraître en poche, chez 10/18.
Roman bref, dense, magnifique, "Home" a la force du conte. Il met en scène Frank Money, 24 ans, de retour de la guerre de Corée. Le jeune Noir, ce qu'on apprend pas tout de suite, est le seul rescapé du trio d'amis auquel il appartenait, ado, à Lotus, en Géorgie. Hanté par leurs fantômes, il tarde à rentrer chez lui. Sa décision viendra quand il apprend que sa jeune sœur, la naïve Cee, de quatre ans sa cadette, risque de mourir. Il plaque tout, et même la chouette Lily qui l'avait un peu raccroché à la vie. Frank va traverser tous les Etats-Unis pour retrouver Cee et l'arracher à son bourreau. Il la confiera, bien mal en point, à des femmes qui vont parvenir à l'incroyable, la ressusciter.
Cent cinquante pages magistrales, piquetées d'humour, remarquablement traduites, suffisent à Toni Morrison pour donner un roman superbe qui dit tout de l'Amérique des années 50: le racisme, le maccarthysme, le retour des vétérans de Corée, la pauvreté, l'oppression des Noirs par les Blancs, des femmes par les hommes. Brillent les lumières de la solidarité, entre Noirs bien sûr via notamment la Green Card, mais venant aussi de Blancs. "Home" est surtout le roman de l'immense amour fraternel entre Frank et Cee, deux personnages imaginaires, deux enfants malmenés par des puissants dont leur méchante grand-mère, unis mais parfois si faibles face à tout ce qui les entoure. À la fin, grandis tous les deux, ils trouveront, ce "home", cette "maison" du titre à laquelle ils aspirent.
 |
| Toni Morrison au Festival America 2012, accompagnée de son interprète,
Dominique Chevallier. (c) Sophie Bassouls. |
Quels merveilleux souvenirs que cette rencontre à Vincennes en septembre dernier!
Pantalon et pull noirs, veste vert pistache, une bague étincelante au doigt, longs dreads gris sous son chapeau de paille, les ongles faits, Toni Morrison est tout sourire. Elle nous parle de son dernier livre. "Home" est dédié à son fils Slade avec qui elle créa deux albums pour enfants, illustrés par notre compatriote Pascal Lemaître dont le nom la fait sourire et qu'elle salue par notre intermédiaire.
Pourquoi avez-vous choisi les années 50 ?
Parce que c'est la décennie de ma jeunesse, celle où je suis arrivée à ma majorité, celle où j'avais vingt ans. J'étais à l'époque indifférente, centrée sur moi. C'est la décennie qui précède les droits civiques. Tout était caché, tout était en même temps en germe. C'est tout ce que l'histoire nationale essaie d'effacer dont j'ai voulu parler.
Votre roman est entrecoupé de parties où Frank dit « je » et raconte des passages plus anciens. Comment s'est mis en place ce procédé ?
Je n'avais pas prévu de l'écrire ainsi. Je voulais donner une voix à Frank mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le laisser tout dire, parce qu'il ne sait pas tout. J'ai donc pris la parole mais je lui ai permis d'intervenir, de critiquer l'auteur, même de mentir à l'auteur. Mais il fallait que je lui laisse la parole au final.
"Home" est le titre du roman et le dernier mot du livre. C'était voulu ?
Au départ, je ne l'avais absolument pas prévu. À un moment, Cee, la sœur, dit: "Je veux rester ici. Ici, c'est chez moi, c'est mon home". Mon éditrice m'a dit: "Si tu enlèves ce passage de là, il faut vraiment que ce soit le dernier mot du roman.". De même pour le titre, c'est elle qui l'a choisi. Je suis très mauvaise pour ça. Mais ma merveilleuse éditrice me permet de m'élargir. Le principe de l'Amérique, c'est que tout le monde vient d'ailleurs. Hier et encore aujourd'hui. Tout le monde est exilé, qu'il soit pourchassé ou riche ou sans autre choix que celui d'aller en Amérique. On a la notion de ce "Home", un chez soi qui est plus qu'un lieu, qui est un état mental, une utopie où on se sent protégé.
Cee a le dernier mot du livre. Cela veut-il dire qu'elle a grandi ?
Oui, elle a grandi, elle a évolué, elle a mûri, elle est devenue une femme indépendante, elle n'a plus besoin de son frère comme protecteur. Et c'est pour cela qu'à la fin, je réunis à nouveau le frère et la sœur et je fais dire à Cee: "Viens, mon frère, on rentre à la maison".
Pourquoi avoir choisi un personnage masculin alors que vous avez souvent raconté des femmes?
Ce qui m'intéressait, ce n'était pas le personnage masculin mais le couple frère-sœur. Un couple dont on ne parle presque jamais en littérature. C'est une relation sans culpabilité, sans arrière-plan sexuel. Frank et Cee sont un peu comme Hansel et Gretel.
Le livre débute par un poème sur une maison, sa serrure et sa clé.
Ce sont les paroles d'une chanson que j'ai écrite. Mais quand j'ai entendu la musique, je ne l'ai pas aimée. J'ai donc retiré le poème et je l'ai mis au début de mon livre.
Suit alors une scène magnifique et mystérieuse avec des chevaux…
C'est celle que j'ai écrite en premier lieu. Je voulais commencer par cette scène mais je ne savais pas comment les chevaux se battent. J'avais une triple idée pour ce début, la beauté, la brutalité et le fait que les chevaux sont comme des hommes. Qu'est-ce qu'être un homme? L'idée court à travers tout le livre. Les rôles s'inversent entre les hommes et les chevaux. Les chevaux se comportent comme des hommes et les hommes se comportent comme des animaux. Cette frontière est très fluctuante. Être viril signifie d'abord pour Frank la brutalité. Il fait un grand voyage, assorti d'épreuves, pour sauver sa sœur. Il vient de Corée, endroit d'une extrême brutalité, et va vers le sud pour sauver sa sœur. Mais les Etats-Unis sont aussi un champ de bataille. Ce n'est qu'au terme de cela que Frank se rend compte qu'il n'est pas obligé de recourir à la brutalité. Cee devient indépendante. A la fin, ils sont sur un pied d'égalité. Tous mes personnages, dans tous mes romans, connaissent la rédemption ou, en tout cas, ils en savent davantage sur eux-mêmes à la fin. Ils ont appris quelque chose sur eux.
Les femmes sont magnifiques, Cee, celles qui la soignent, Ethel.
Ces femmes vont vous rassurer, vous consoler, vous soigner, vous rendre fort mais surtout ne comptez pas sur elles pour s'apitoyer sur votre sort, elles vous veulent fort. Ce sont des affaires de femmes, sans qu'il y ait des hommes autour. Elles sont les vraies citoyennes de "Home".
Votre écriture est très musicale.
La musique est extrêmement importante parce qu'elle est notre voix. Les Noirs étaient forcés au silence, ils étaient empêchés de parler. La musique a servi de code. Les spirituals indiquaient les lieux où se retrouver, mais avec les accents religieux, cela passait. Le blues a exprimé la liberté dans le sud où on ne pouvait pas se marier avec qui on voulait. Le jazz a exprimé entre autres la liberté sexuelle, il est plus joyeux, plus urbain. Les musiciens sont toujours en avance dans la compréhension des changements culturels. Après Hiroshima, cela a été le scat et le be-bop. Ils avaient compris que ce ne serait plus jamais pareil.
Quelles sont vos influences littéraires?
Il y a trois auteurs qui ont compté pour moi. William Faulkner qui, même dans les années 40, était très en empathie avec la culture noire, ce qui se sent dans le rythme de son écriture. James Baldwin qui, surtout dans ses essais, a frappé l'universitaire que j'étais parce qu'il était le premier à avoir ce style d'écriture, avec des affinités politiques jamais dénuées de tendresse. Gabriel Garcia Marquez enfin, parce qu'il a mis de la magie et des fantômes dans sa narration sans s'en excuser.
Vos romans semblent de plus en plus courts.
Ecrire moins pour dire plus, c'est délibéré de ma part.