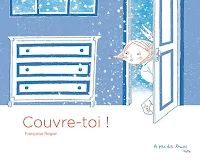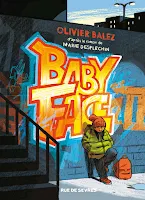EDIT 07/11/24:
L'Académie française vient de publier la version illustrée de son palmarès.
Elle est consultable
ici.

|
L'écrivain Philippe Leuckx et le chanteur Adamo.
|
Si on ne vote pas chaque année en juin, c'est le moment où est publié le long
palmarès de l'Académie française. 67 distinctions pour l'année 2024, le Grand Prix du Roman étant lui décerné
à l'automne. Parmi les distingué.e.s, deux Belges, le chanteur
Adamo et l'écrivain
Philippe Leuckx pour un
texte de poésie. Blague belgo-belge: se cache-t-il un ingénieur ailleurs dans
le palmarès?
On remarquera aussi dans la liste entre autres noms celui d'Emmanuel Kherad
dont l'émission de radio "La librairie francophone" vient d'être crucifiée par
France Inter.
PALMARÈS DE L'ANNÉE 2024
GRANDS PRIX
Grand Prix de la FrancophonieM. Abdelfattah Kilito (Maroc)
Grande Médaille de la FrancophonieM. Edwin M. Duval (États-Unis)
Grand Prix de Littérature Paul MorandM. Marcel Cohen, pour l'ensemble de son œuvre
Grand Prix de Littérature Henri GalPrix de l'Institut de FranceMme Cécile Wajsbrot, pour
l'ensemble de son œuvre
Prix Jacques de FouchierGénéral
François Lecointre, pour Entre guerres
Prix de l'Académie française Maurice GenevoixMme Alice Renard, pour La Colère et l'Envie
Grand Prix Hervé DeluenM. Constantin Sigov (Ukraine)
Prix Léon de RosenPlantu, pour "Sale Temps pour la planète"
Grand Prix de PoésieMme Hélène Dorion, pour l'ensemble de son œuvre poétique
Grand Prix de PhilosophieM. Ruedi Imbach, pour l'ensemble de son œuvre
Grand Prix MoronM. Daniel S. Milo, pour "La Survie des médiocres. Critique du
darwinisme et du capitalisme"
Grand Prix GobertMme
Jacqueline Lalouette, pour "L'Identité républicaine de la France. Une
expression, une mémoire, des principes et l'ensemble de son œuvre"
Prix de la Biographie (littérature)M. Claude Burgelin, pour "Georges Perec"
Prix de la Biographie (histoire)MM. Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, pour "L'Œuvre-vie
d'Antonio Gramsci"
Prix de la CritiqueMme Anne Michelet,
pour son travail de critique de presse
Prix du cardinal LustigerR. P. Jean-Miguel Garrigues, o. p., pour "L'Impossible Substitution.
Juifs et chrétiens (Ier-IIIe siècle)" et l'ensemble de son œuvre
Prix de la NouvelleM. Bertrand de Saint Vincent, pour "Une certaine désinvolture"
Prix d'AcadémieM. Olivier Charneux, pour "Le Glorieux et le Maudit. Jean Cocteau-Jean
Desbordes: deux destins"
M. Alain Fleischer, pour l'ensemble de ses
nouvelles
M. Jonathan Siksou, pour "Vivre en ville"
M. Pierre
Singaravélou, pour "Fantômes du Louvre. Les musées disparus du XIXe siècle"
Prix du ThéâtreM. Florian Zeller, pour l'ensemble de son œuvre dramatique
Prix du Jeune Théâtre Béatrix Dussane-André RoussinMme Élodie Menant, pour ses ouvrages dramatiques
Prix du Cinéma René ClairM. Pascal Bonitzer, pour l'ensemble de son œuvre cinématographique
Grande Médaille de la Chanson françaiseM.
Salvatore Adamo, pour l'ensemble de ses chansons
Prix du rayonnement de la langue et de la littérature françaisesM. Arnaud Antona, professeur des écoles au lycée français de Singapour,
qui a mis au point une méthode d'apprentissage de la lecture utilisée à
Singapour et à Hong Kong;
M. Emmanuel Khérad, journaliste et producteur
de l'émission "La Librairie francophone";
M. Dana Kress, professeur de
français, directeur exécutif des presses du Centenary College of Louisiana et
promoteur, à la tête des éditions Tintamarre, de la littérature francophone
louisianaise;
M. Francesco Massa, historien italien spécialiste des
religions antiques, qui a récemment publié "Les Cultes à mystères dans
l'Empire romain. Païens et chrétiens en compétition"
Mme Marie-Christine
Vandoorne, qui a occupé des postes de direction au sein de l'Alliance
française ou de l'Institut français aux Pays-Bas, en Irlande, à Paris, Tétouan
ou Athènes
PRIX DE POÉSIE
Prix Théophile Gautier
M. Patrice Delbourg, pour "Le Singe du
side-car"
Prix Heredia
M. Christophe Manon, pour "Porte du
Soleil"
Prix François Coppée
M.
Philippe Leuckx, pour "Le Traceur d'aube" (Al Manar)
Prix Paul Verlaine
M.
Emmanuel Godo, pour "Les Égarées de Noël"
Prix Lucette Moreau
M. Guillaume Decourt, pour "Lundi propre"
PRIX DE LITTÉRATURE ET DE PHILOSOPHIE
Prix Montyon
MM. Guillaume Alonge et Olivier Christin, pour "Adam
et Ève, le paradis, la viande et les légumes"
Prix La Bruyère
M. Paul Clavier, pour "Les Avatars de la preuve cosmologique. Essai sur
l'argument de la contingence"
Prix Jules Janin
M. Pierre
Deshusses, pour sa traduction des œuvres de Joseph Roth
Prix Mabillon
M. Florent Rouillé, pour sa traduction de l'"Anticlaudianus" d'Alain de
Lille
Prix Émile Augier
M. Nasser Djemaï, pour "Les
Gardiennes ou le Nœud du tisserand"
Prix Émile Faguet
M.
Nicolas Bourguinat, pour "L'Avenir est gros! Temps, espace et destinée dans
L'Éducation sentimentale"
Prix Louis Barthou
M. Jean-Félix de
La Ville Baugé, pour "Magnifique"
Prix Anna de Noailles
Mme
Violaine Huisman, pour "Les Monuments de Paris"
Prix François Mauriac
Mme Lilia Hassaine, pour "Panorama"
Prix Georges Dumézil
M. Alexandre Surrallés, pour "La Raison lexicographique. Découverte des
langues et origine de l'anthropologie"
Prix Roland de Jouvenel
M. Paul Saint Bris, pour "L'Allègement des vernis"
Prix Biguet (philosophie)
M. Frédéric Berland, pour "Les Logiques absurdes. De la dialectique
néoplatonicienne aux logiques non classiques"
Prix Biguet (sociologie)
M. Mikael Askil Guedj, pour "Médecins malgré vous. Portrait des
maladies du XXIe siècle"
Prix Ève Delacroix
Mme Isabelle
Sorente, pour "L'Instruction"
Prix Jacques Lacroix
M. Laurent
Tillon, pour "Les Fantômes de la nuit. Des chauves-souris et des hommes"
Prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne
M. Bruno Karsenti, pour "La Place de Dieu. Religion et politique chez
les modernes"
PRIX D'HISTOIRE
Prix Guizot
M. Jean-Marc Schiappa, pour "Gracchus Babeuf"
M.
Frédéric Régent, pour "Libres de couleur. Les affranchis et leurs descendants
en terres d'esclavage (XIVe-XIXe siècle)"
Prix Thiers
MM.
Olivier Dard et Jean Philippet, pour "Février 34. L'affrontement"
Prix Eugène Colas
Mme Monique Cottret, pour "L'Europe des Lumières (1680-1820)", coécrit
avec Bernard Cottret (†)
M. Michel Pierre, pour "Histoire de l'Algérie.
Des origines à nos jours"
Prix Eugène Carrière
Mme Marie
Fournier, pour "Nicolas-Guy Brenet (1728-1792)"
M. Pierre Sérié, pour
"Résistances à l'idée d'art moderne dans la peinture. Paris, Londres, New
York, 1848-1931"
Prix Louis Castex
M. Gérard Guerrier, pour
"Rêves d'Icare. Pionniers et aventuriers du vol non motorisé"
Prix Monseigneur Marcel
M. Olivier Guerrier, pour "Visages singuliers du Plutarque humaniste.
Autour d'Amyot et de la réception des Moralia et des Vies à la Renaissance"
Mme
Anaïs Thiérus et M. Damien Millet, pour "Les Chappuys d'Amboise. Chronique
historique d'une famille lettrée de la Renaissance"
Prix Diane Potier-Boès
Mme Ons Trabelsi, pour "Sīdī Molière. Traduire et adapter Molière en
arabe (Liban, Égypte, Tunisie, 1847-1967)"
Prix François Millepierres
M. Daniel Marguerat, pour "Paul de Tarse. L'enfant terrible du
christianisme"
Prix Augustin Thierry
M. Aurélien Robert, pour
"Le Monde mathématique. Marco Trevisano et la philosophie dans la Venise du
Trecento"
PRIX DE SOUTIEN À LA CRÉATION LITTÉRAIRE
Prix Henri de RégnierM. Philippe Lacoche, après "Oh, les filles!"
et "Les Ombres des Mohicans"
Prix AmicMme Clara Arnaud,
après "Et vous passerez comme des vents fous"
Prix MottartM.
Mokhtar Amoudi, après "Les Conditions idéales"

.jpg)
.jpg)
.jpg)


.png)